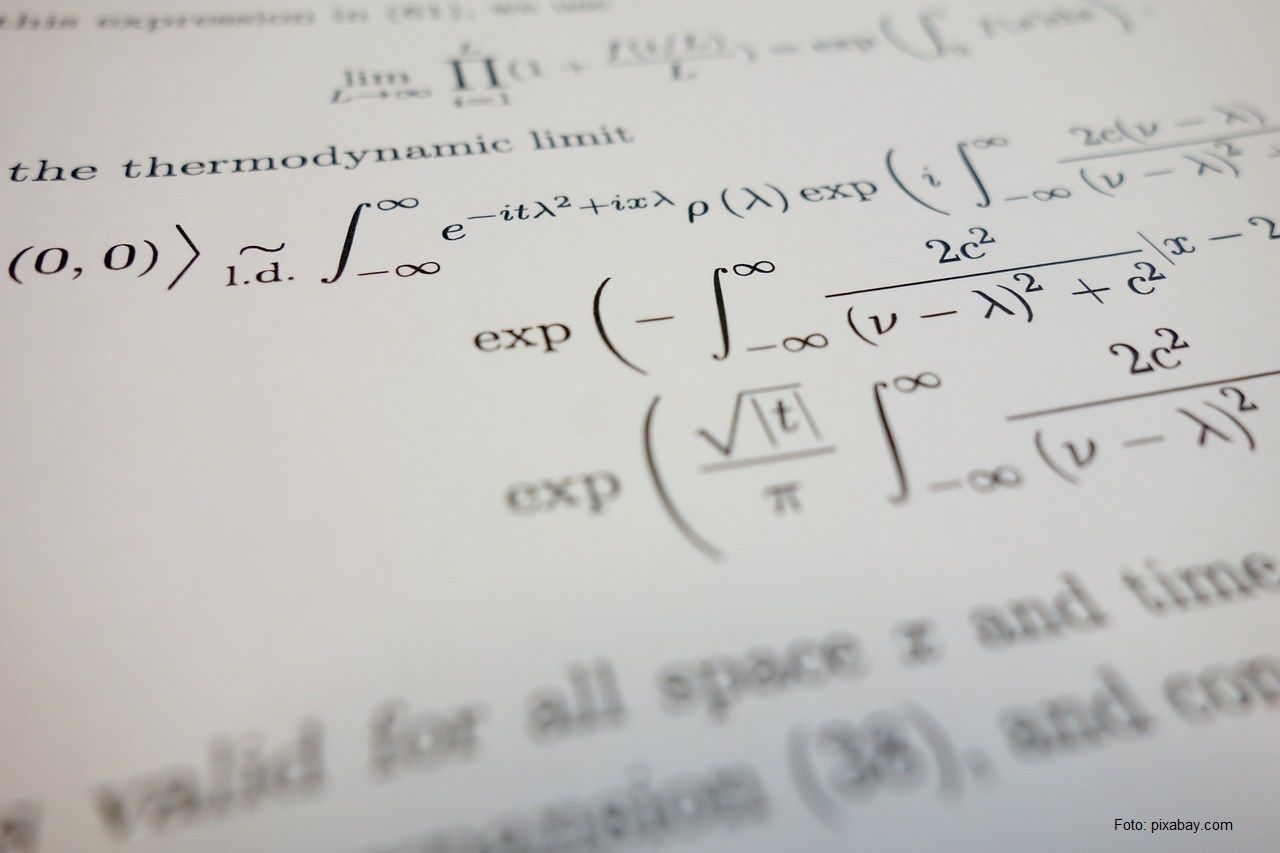Le retour de Donald Trump à la Maison Blanche pour son second mandat a été suivi de près par les analystes friands de comprendre le nouveau cours que prendra la politique américaine. Une politique annoncée par le slogan « Let’s make America great again », tel qu’avait été le début du discours d’investiture de Donald Trump. Et, en effet, ses partisans tout comme ses détracteurs n’ont pas eu à attendre longtemps. Au-delà de la lutte contre l’inflation et des engagements en matière de défense, le président américain a signé un décret compliquant les démarches administratives pour les personnes transgenres et non-binaires en les empêchant d’accéder à la transition de genre hormonale. Un autre texte ordonne la fin de tout programme de diversité et d’inclusion au sein du gouvernement fédéral. Pour lutter contre l’immigration illégale, le président a signé un ordre exécutif qui prévoit le déploiement de 1 500 militaires supplémentaires à la frontière avec le Mexique, une mesure qui fait suite à des décisions prises juste après son investiture, dont la déclaration d’un état d’urgence à la frontière sud des Etats-Unis. Dans la même veine, dorénavant, la nationalité américaine ne sera plus octroyée automatiquement aux enfants nés sur le sol américain, en étant exclus les enfants issus des parents illégaux. Enfin, pour protéger l’industrie américaine, Donald Trump a dès le début de son mandat lancé une analyse des partenariats commerciaux avec ses voisins, menaçant le Canada et le Mexique des droits de douane de 25% à partir du 1er février. Au niveau international, les Etats-Unis se sont retirés de l’OMS et, à nouveau, de l’Accord de Paris sur le climat. Des mesures qui font frissonner certains. Iulia Joja, professeur à l’Université Georgetown explique :
« Trump entend semble-t-il vouloir redorer le blason américain, fut-ce en mettant à mal ses alliés et la politique étrangère et de sécurité internationale. Mais la vision de Trump est une vision transactionnelle, une vision du court terme qui vise à engranger des résultats pour la durée de son mandat présidentiel. A long terme en revanche, sa politique risque de coûter cher aux Etats-Unis. Mais Trump ne pense pas en ces termes. Malgré tout, il n’est pas sûr qu’à court terme, la politique de taxation des biens importés de Chine et d’autres pays qu’il entend mener ne fassent que des heureux. Car cela se traduira en vérité par une hausse des prix sur le marché américain. »
En Europe, l’arrivée de Donald Trump à la Maison Blanche augmente les craintes de voir les relations transatlantiques mises sous pression. Invité à s’exprimer à ce sujet au micro de Radio Roumanie, le chef de la diplomatie de Bucarest, Emil Hurezeanu, explique :
« Il n’est pas exclu de constater un changement de perspective de la part des décideurs américains. Néanmoins, les intérêts géopolitiques des Etats-Unis ne peuvent ignorer le partage des valeurs et des intérêts que ce pays a avec ses alliés traditionnels que sont les Européens. Certes, il se puisse que le centre d’intérêt des Etats-Unis se déplace vers le Pacifique, vers la Chine. Mais cet espace économique puissant, riche de ses 400 millions d’habitants, que constitue l’UE, ne pourra pas être ignoré par les décideurs américains ».
Pour ce qui est de l’issue de la guerre en Ukraine qu’avait constitué un cheval de bataille pour la campagne présidentielle de Donald Trump, elle demeure toujours incertaine, selon le chef de la diplomatie de Bucarest :
« L’issue de la guerre en Ukraine demeure encore et toujours incertaine. L’UE a aidé l’Ukraine avec plus de 150 milliards de dollars, les Etats-Unis ont fourni 180 milliards jusqu’à l’heure actuelle. Mais au-delà du coût financier, il existe une mise géopolitique, des intérêts à long terme, des intérêts vitaux pour les Etats-Unis. Car une éventuelle victoire de la Russie risquerait de rabattre les cartes aux niveaux régional et international d’une manière extrêmement dangereuse. Le président Trump a fait la promesse de conclure la paix. Il faudrait voir dans quelle mesure cette volonté se traduira dans les faits. Il a nommé pour l’instant un nouvel envoyé spécial pour l’Ukraine et la Russie, un général à la retraite qui dispose d’une expertise respectable et considérable en ce domaine et qui a depuis toujours eu à cœur de défendre les intérêts traditionnels des alliés occidentaux des Etats-Unis. Et puis, la diplomatie américaine demeure puissante et elle aura aussi son mot à dire à ce sujet, peu importe les changements opérés à sa tête ».
Quoi qu’il en soit, si dans son discours d’investiture Donald Trump a évité de mentionner les crises de sécurité actuelles, dont notamment les guerres d’Ukraine et du Moyen-Orient, il a annoncé la couleur de pacificateur et d’unificateur de son mandat. « Nous allons mesurer nos victoires non tant à l’aune des guerres que nous allons gagner que des traités de paix que nous allons conclure et, surtout, à l’aune des guerres que nous allons savoir éviter », a souligné Donald Trump. Un discours qui, fait notable, a fait également fi de la traditionnelle rivalité des Etats-Unis avec la Chine.
(Trad. Ionut Jugureanu)