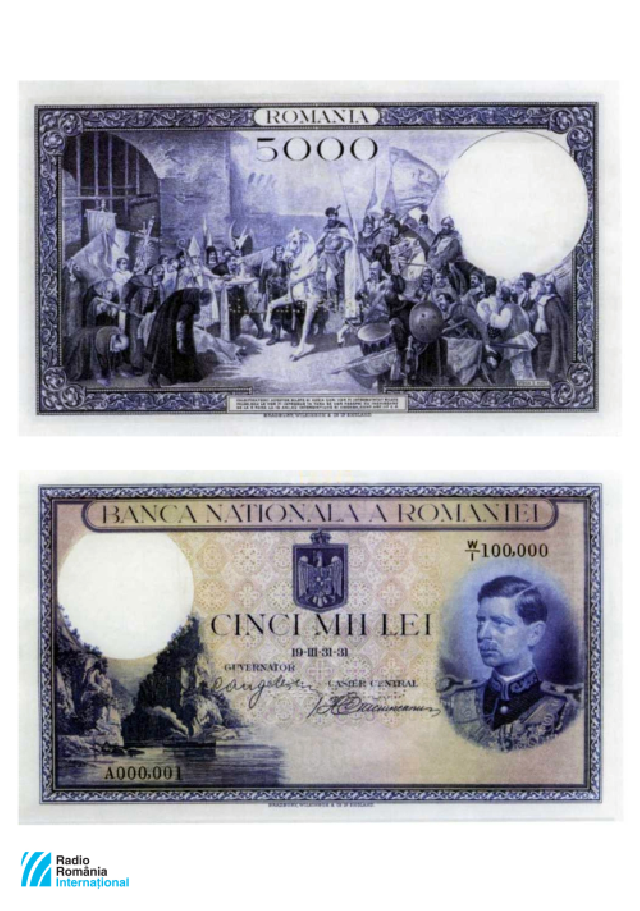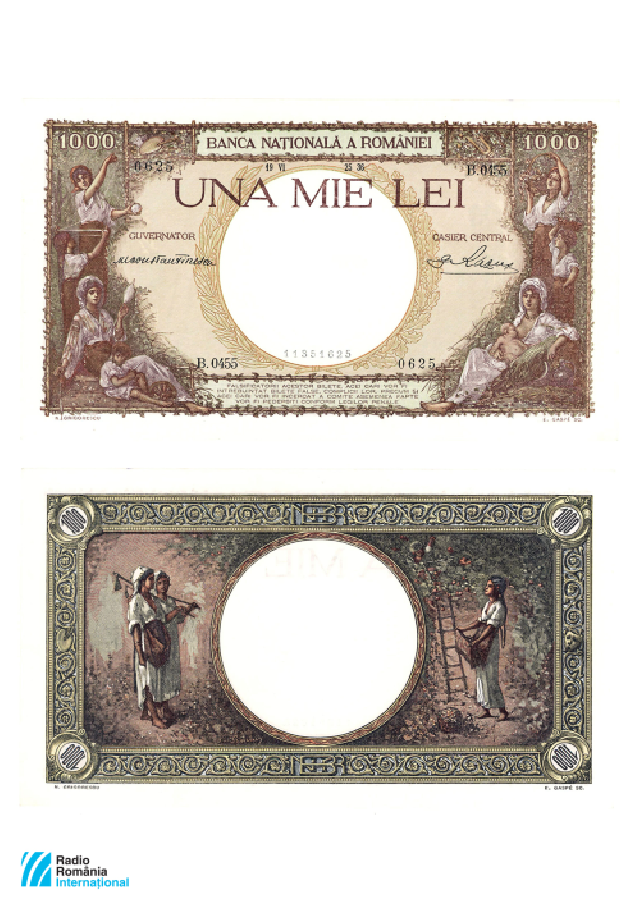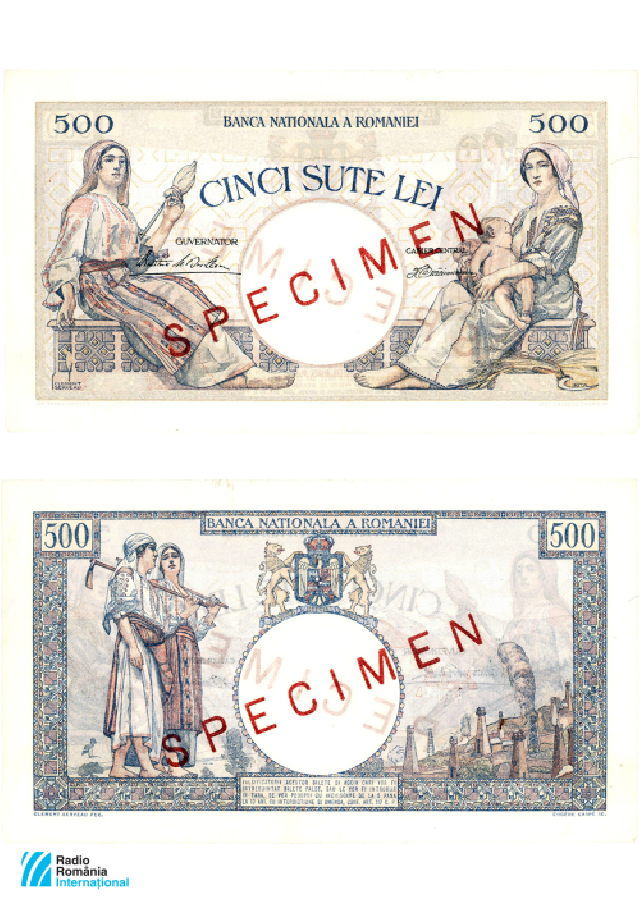C’est l’endroit idéal pour sentir l’énergie de la ville, vivre la joie des rencontres et sentir le frémissement des passants. Un véritable spectacle urbain, avec pour décor une collection de sept styles architecturaux des plus captivants : baroque, classique, éclectique, historique, Sécession, romantique et néo roumain.
La Piaţa Unirii, connue aussi sous le nom de Piaţa Mică (la Petite Place), date du XVIIIe siècle, quand elle était le cœur du quartier dit de la Ville nouvelle. Le premier bâtiment que l’on y a fait construire fut la Maison Serföyö, en 1714, sur l’emplacement où existe de nos jours le Palais de l’Aigle noir. Avec seulement quelques pièces, la Maison Serföyö s’est transformée en une auberge, très connue à l’époque, appelée « L’Aigle ». À compter de 1753, la place a connu plusieurs transformations. Elle a accueilli des édifices impressionnants renvoyant à différents styles architecturaux et s’est vu doter de l’éclairage public et des premiers tramways reliant le centre-ville à la Gare du Nord et à la partie ouest de la ville.
Sur l’ensemble des transformations qui ont contribué à l’image actuelle de la Place de l’Union, les plus importantes sont intervenues au moment de l’essor industriel, au moment du passage d’un siècle à l’autre. Malgré la diversité des activités qui s’y sont déroulées à travers les époques et malgré les multiples changements de nom connus : la Petite Place, la Place Saint Ladislas, la Place Ferdinand, la Place Malinovski ou la Place de la Victoire et enfin la Place de l’Union, cet endroit représente le centre culturel et historique de la ville, un lieu de promenade privilégié où chaque visiteur doit se rendre lors d’un séjour à Oradea.
Des dizaines de milliers de touristes sont attirés par les édifices historiques qui bordent cette place : l’Hôtel de Ville d’Oradea (1901-1903), le Palais de l’Évêché gréco-catholique (1903-1905), le Palais de l’Aigle noir (1907-1908) ou encore le Palais Moskovitz Adolf et fils (1904-1905) auxquels s’ajoutent de nombreux restaurants et cafés qui animent cette place.