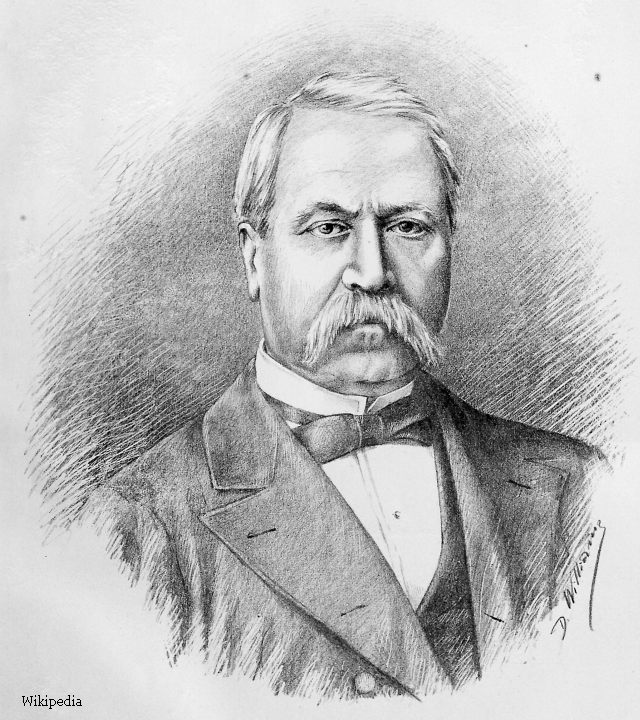En 1887 était inauguré le premier établissement de cure à Govora les Bains, ville d’eaux renommée pour les propriétés thérapeutiques des ses eaux salées et iodurées et de sa boue sapropélique.
Située dans le sud-ouest de la Roumanie, au pied des Carpates, Govora les Bains est une ville avec une riche histoire. C’est ici que vous trouverez une musée balnéaire exposant des appareils médicaux datant des débuts de la station et de l’entre-deux-guerres. Govora les Bains a beaucoup changé ces dernières années, affirme son maire, Mihai Mateescu: « Le parc balnéaire dont les allées s’étalent sur 6950 mètres a été réhabilité. On a aménagé une chute d’eau aux lumières. On a renouvelé les bancs et les lampadaires. Le projet du parc balnéaire appartient au grand architecte français Emile Pinard, qui avait conçu les allées à des fins de cure et non pas de promenade. Nous avons gardé le squelette du projet initial et nous y avons ajouté un amphithéâtre en plein air, sur le modèle des arènes romaines, pour que le gens puissent s’y recréer pendant l’été et assister aux spectacles consacrés aux fêtes de fin d’année pendant l’hiver. Tout cela pour attirer plus de touristes, pas seulement des clients. Nous nous adressons aussi aux enfants et aux jeunes, car eux aussi ils peuvent bénéficier des cures de Govora les Bains ».
Vu que l’air est fortement ionisé à Govora, et que la station est traversée par une rivière, les falaises ne pouvaient surtout pas manquer. S’étalant sur 1 km et demi, elles ont été construites sur le modèle des falaises de la célèbre station thermale allemande de Baden — Baden.
Mihai Mateescu, maire de Govora les Bains: « Il y a un itinéraire mirifique à travers la forêt pour ceux qui font des cures thermales chez nous. En fait chaque rue est a été conçue comme un trajet touristique en miniature. Il y a de vieux bâtiments qui doivent encore être restaurés et qui témoignent de l’architecture spécifique de la zone. D’ailleurs, nous n’avons prévu que des restaurations dans la ville, excluant toute modification ou démolition. Le tout pour mettre en valeur les trajets touristiques menant aux monastères, à l’aéroport ou encore vers une destination de plus en plus connue de Roumanie, à savoir la route Transalpina ».
L’histoire de la station thermale est également étroitement liée au nom de la princesse Elisabeth de Wied, celle qui allait devenir reine de Roumanie suite au mariage avec le roi Carol Ier de Hohenzollern-Sigmaringen. Elle a écrit une cinquantaine de volumes de poésie, d’essais et de prose en français, allemand, anglais, roumain, latin et grec.
Tous ces volumes, elle les a signés sous le pseudonyme Carmen Sylva, qui provient du latin et qui signifie « le chant de la forêt ». Afin de rendre hommage à la Reine Elisabeth, l’actuel maire de la ville de Govora les Bains, Mihai Mateescu, souhaite refaire l’itinéraire qu’elle suivait en carriole. Jusqu’à l’aménagement de l’itinéraire, vous pouvez pourtant admirer la salle de cinéma conçue en 1929 par la première femme architecte d’Europe, Virginia Haret Andreescu.
Par ailleurs, les jeunes passionnés par les sports urbains peuvent trouver dans cette ville d’eaux des pistes cyclables et des endroits aménagés pour les pratiquants de la planche à roulettes et pour les rollers. Et si vous arrivez à Govora les Bains à la mi-août, vous aurez l’occasion de participer aux Journées de la ville, avec au programme pièces de théâtre et spectacles en plein air ainsi que des feux d’artifice.
Et depuis quelque temps, la ville accueille de plus en plus d’événements, affirme Mihai Mateescu, maire de la ville Govora les Bains: « Nous avons accueilli les championnats du monde et d’Europe d’orientation touristique. Le cadre naturel est parfaitement adapté à ce que nous souhaitons réaliser dans le domaine du tourisme actif. Nous avons fait appel aux professionnels pour concevoir le plan d’urbanisme de la ville. Nous avons réalisé une étude sur l’histoire de la ville, un de nos plus importants projets. Elle a été réalisée par les étudiants de l’Institut national d’architecture, sous la direction d’un professeur exceptionnel : Sergiu Nistor. C’est à partir de cette étude que nous avons réalisé un règlement d’urbanisme que tous les responsables municipaux devraient respecter à l’avenir. »
Selon les chiffres rendus publics par le Conseil départemental de Vâlcea, la ville d’eaux de Govora des Bains dispose de près de 1900 places d’hébergement dans 5 hôtels, 14 villas et 3 campings. Et pourtant, afin de bénéficier de prix imbattables, tant pour l’hébergement que pour les cures, il vaut mieux faire des réservations à l’avance, affirme Bogdan Pistol, vice-président du Conseil départemental de Vâlcea qui souhaite transmettre aussi des voeux aux auditeurs de RRI : « D’abord je souhaite les féliciter d’écouter Radio Roumanie Internationale, une véritable marque enregistrée de la Roumanie et je les prie de venir dans le comté de Vâlcea parce que nous offrons d’excellents services touristiques, dans de nouveaux hôtels et gîtes ou bien dans des établissements rénovés. Nous avons par exemple un hôtel quatre étoiles, dont les conditions sont similaires à celles proposées par Karlowy Vary. Cette station thermale est un exemple parfait de la cohérence en urbanisme. Le parc balnéaire est modernisé et les conditions d’hébergement sont au superlatif. Bref, dans le comté de Vâlcea, vous pouvez passer un séjour d’une semaine très varié. Impossible de vous ennuyer. »
Notre concours se poursuit. Nous allons revenir à Govora les Bains pour vous offrir plus de détails sur les différentes cures que cette ville d’eaux propose. N’oubliez pas de répondre correctement à nos questions jusqu’au 30 avril, le cachet de la poste faisant foi, afin de gagner un séjour à Govora les Bains. (trad. Valentina Beleavski, Alex Diaconescu)