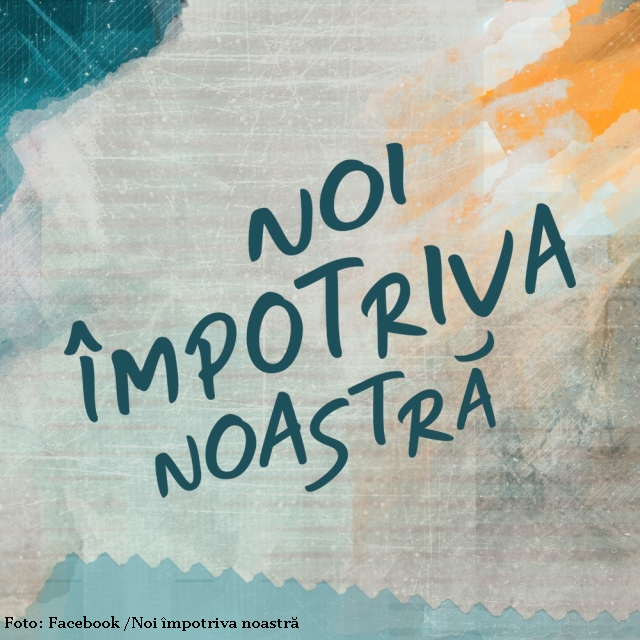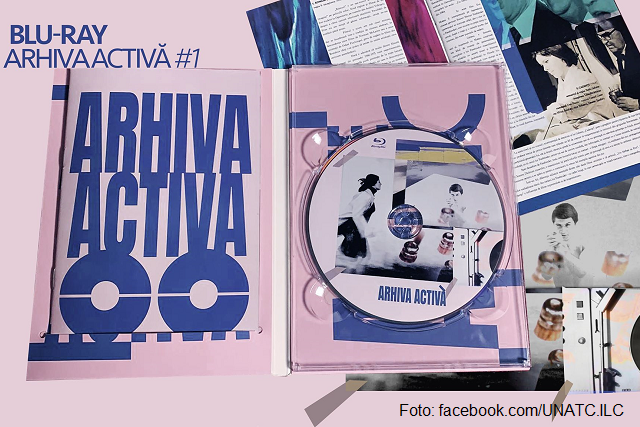Organisé
par l’association Qolony – La colonie pour l’art et la science – et cofinancé
par le Centre culturel ARCUB de la Mairie de Bucarest, le projet Open Practice
Society se déroule dans le cadre du Programme Bucarest – ville ouverte 2021. Il
soutient l’infrastructure et le développement des Ateliers Malmaison, un accès
plus facile du public aux initiatives artistiques de cette communauté d’appui
actif aux jeunes artistes.
Vieux
de 177 ans, le bâtiment Malmaison, une caserne à l’origine, a une importance historique
remarquable. Il a servi d’Ecole d’officiers des armées, de tribunal militaire, de
prison pendant le régime du maréchal Antonescu et de centre d’enquête et de
détention de la Securitate (la police politique) au début du régime communiste.
A
l’heure actuelle, les Ateliers Malmaison se proposent de réintroduire le
bâtiment dans le circuit vivant de la ville et d’inaugurer un nouvel âge de sa
longue histoire. Ils sont à la fois une communauté artistique et un espace
partagé par des artistes, ateliers, projets et galeries d’art de la capitale
roumaine.
L’Open
Practice Society cible en égale mesure la communauté artistique, les nouvelles
générations d’artistes et le grand public de Bucarest. A travers les
conférences données par des acteurs de poids du secteur culturel, tels qu’artistes
avec une notoriété internationale, commissaires d’expositions ou galeristes, l’Open
Practice Society a pour but d’offrir, aux élèves et aux étudiants entre 16 et
20 ans, une alternative au programme éducationnel habituel, en leur donnant la
possibilité de travailler avec des artistes internationalement connus.
Mihaela
Ghiță, membre de l’association Qolony et journaliste à Radio Roumanie Culture,
explique : «Nous avons passé ces informations, utiles aux jeunes
apprentis, au Lycée d’arts plastiques « Nicolae Tonitza », à
l’Université nationale des arts de Bucarest, au Collège (lycée) national « Sfântul
Sava », au Collège (lycée) national « Octav Onicescu ».
D’ailleurs, un professeur d’arts du Collège (lycée) national « Sfântul
Sava » a assisté à l’inauguration du projet. Nous faisons de notre mieux
pour le promouvoir partout où il y a des élèves et des étudiants qui souhaitent
mettre en œuvre des projets artistiques. Nous insistons sur cette activité
pratique alternative, qui n’est pas enseignée à l’école, mais qui fait partie
de l’expérience des artistes concernés. En fait, on peut dire que nous sommes
en train de déblayer le terrain, d’y introduire un nouveau style, avec un
système moins classique, moins conservateur, de learning by doing,
d’apprentissage par la pratique, l’imagination et la créativité pouvant ainsi
s’exprimer en toute liberté. N’oublions pas que l’art du moment est assisté par
la technologie et par des choses alternatives, proches plutôt de la science que
de l’aisance. C’est ce qui rend nécessaire cette éducation visuelle, cette
éducation artistique des jeunes, puisque l’art trouvera une autre manière de
s’exprimer. Le changement est normal, le monde actuel est complètement
différent de celui d’il y a cent ans, et même d’il y a cinquante ans ou d’à
peine deux ans. Et ces changements naissent de plus en plus de notre
interaction avec l’environnement en ligne. »
L’Open
Practice Society inclut des sessions de mentorat et d’activité pratique avec 9
jeunes, issus de la sélection des candidats et divisés en équipes de trois
membres chacune. Chaque groupe est coordonné par un des artistes, reçoit le
soutien du commissaire d’exposition et du galeriste, et travaille aux Ateliers
Malmaison sur le développement des habilités pratiques.
Mihaela
Ghiță fournit davantage de détails : « Trois
sont les artistes ayant assumé le rôle de mentors : Sabina Suru, qui fait
de l’holographie, Floriana Cândea, une bio-artiste impliquée dans le projet Fusion
Air, et Larisa Crunțeanu, spécialiste du son qui travaille à la frontière entre
vidéo et performance. Nous mettons donc un choix plutôt bien fourni à la
disposition des jeunes qui veulent étudier et se faire la main dans le domaine
de l’art. J’ai mentionné le nom de Sabina Suru, qui est passionnée de
photographie alternative et d’holographie ; cet été, elle a eu une exposition
très complexe, mélangeant danse et holographie. Floriana Cândea est une
bio-artiste qui travaille avec de la matière vivante. Cette année, elle a
participé au projet Fusion Air de résidence artistique avec des
expérimentations réalisées avec les chercheurs de l’Institut national de
recherche et développement en physique des matériaux. Les artistes proposent de
nombreux projets d’éthique, car l’art contemporain, l’art assisté par la
science s’adresse plutôt à l’esprit, s’attaque à des problèmes, fait naître des
émotions, ne nous laisse pas indifférents. Une telle œuvre d’art, qui ne montre
pas nécessairement la maîtrise d’un artiste peintre, a le mérite de poser ces
problèmes d’éthique. »
L’association
Qolony est une organisation sans but lucratif, qui crée des liens entre l’art,
la science et la technologie, entre les professionnels de ces domaines. Créée
en 2019, elle prend appui sur la conviction de ses fondateurs – Mihaela Ghiță,
Sabina Suru et Floriana Cîndea – que les pratiques transdisciplinaires
constituent une source d’idées novatrices. L’association Qolony soutient et
organise des événements divers, tels qu’expositions, conférences, projets de
production, débats entre artistes et scientifiques, résidences artistiques, le
tout construit autour de la recherche scientifique et la création artistique. (Tra. Ileana Taroi)