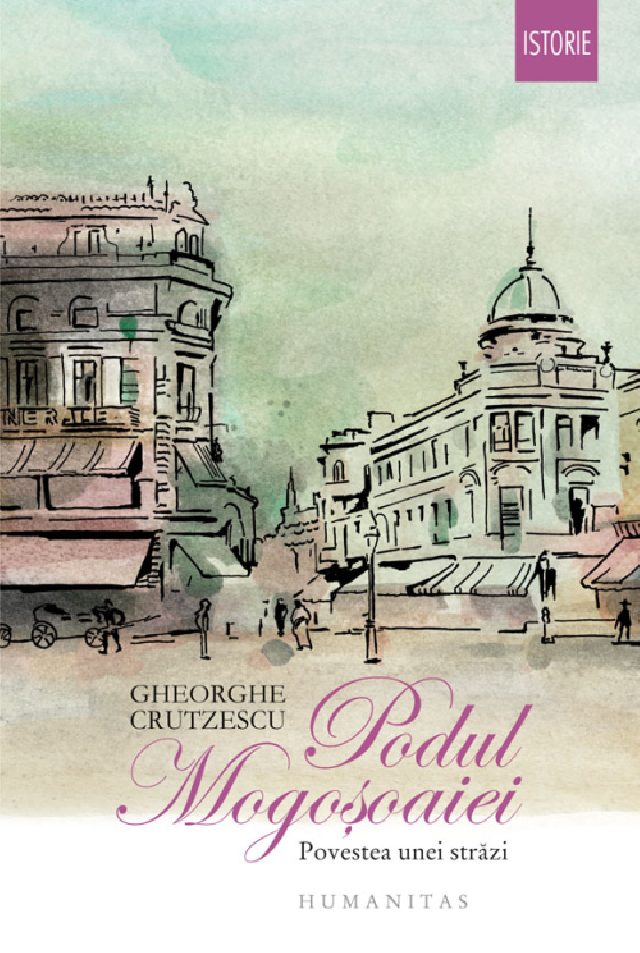Sa création est une conséquence normale de la
fondation, le 1 avril 1866, de la Société littéraire roumaine, dont le nom
allait changer l’année suivante en Société académique roumaine. Deux années
après l’indépendance de la Roumanie, en 1879, l’Académie roumaine, héritière
des deux organisations précédentes, devenait la plus haute institution
scientifique du nouvel État. Créée en 1867, la Bibliothèque de l’Académie commençait à remplir le
rôle qu’elle avait assumé et à constituer son fonds de livres à travers des
dons et des achats. Le bâtiment, qui allait abriter cet immense patrimoine et
qui existe toujours, est érigé à la fin du XIXème siècle, en 1897.
Lors de la séance de constitution de la Bibliothèque, l’évêque
orthodoxe de Buzău et donneur de la première date, Dionisie Romano, annonça un
don initial composé de 81 livres roumains anciens, rassemblés en 73 volumes. En
1897, 25 ans après la mort de l’évêque, son entier fonds de livre allait à la
bibliothèque. D’autres donneurs contribuaient eux-aussi à l’accroissement du
fonds d’imprimés : le médecin Carol Davila, les linguistes Timotei Cipariu
et August Treboniu Laurian, les historiens et archéologues V. A. Urechia,
George Barițiu et Alexandru Odobescu, l’inventeur Petrache Poenaru. Mais la
personnalité qui allait y laisser la plus forte empreinte fut le premier
directeur, le linguiste Ioan Bianu. En 1894, celui-ci imagina un « Plan de
la bibliographie nationale » structuré sur cinq chapitre : rédiger la
bibliographie nationale du livre roumain; rédiger une bibliographie des
publications périodiques roumaines; rédiger une bibliographie analytique, avec
les articles des périodiques; rédiger un catalogue des manuscrits, à commencer
par les roumains; rédiger le catalogue des documents détenus par la
Bibliothèque.
Jusqu’à présent, l’histoire de la Bibliothèque de l’Académie
a fait l’objet de recherches plus ou moins systématiques, un ouvrage exhaustif
se faisant toujours attendre. Un premier volume, sous la coordination du
directeur de l’institution, Nicolae Noica, vient de paraître, les 700 pages en étant
consacrées à l’époque de début, entre 1867 et 1885.
Lors du lancement de ce premier volume de l’histoire de la
Bibliothèque de l’Académie roumain, le président de l’Académie roumaine, l’historien
Ioan-Aurel Pop, a affirmé qu’une histoire de la plus importante bibliothèque de
Roumanie restait un projet important pour au moins une autre génération.
Ioan-Aurel Pop : « Personne n’a jamais écrit une
histoire de la Bibliothèque de l’Académie roumaine en dix volumes, malgré les
très nombreux projets et même des tentatives en ce sens. Et il est peu probable
que quelqu’un le fasse bientôt. C’est la raison pour laquelle le projet actuel,
qui prend vie sous nos yeux à travers ce premier volume, est une réalisation
remarquable. La Bibliothèque de l’Académie roumaine a fait ses premiers pas en 1867,
une année après la création de la Société littéraire, ancêtre de l’Académie
roumaine. Dès le début, sa mission a été celle de rassembler, d’organiser et de
mettre en valeur les collections nationales spécialisées, les collections de
livres, d’élaborer et de publier la bibliographie nationale rétrospective de
tous les types de témoignages imprimés.
Ioan-Aurel Pop a encore précisé que l’institution s’était
constamment développée et que, à l’exemple de tout autre organisme en pleine
croissance, elle avait diversifié et élargi son horizon : « Les objectifs et
les attributions de l’institutions se sont élargis en permanence durant les 155
ans d’existence. À présent, elle est la plus importante bibliothèque-trésor et la meilleure
bibliothèque d’érudition de Roumanie. Ses collections ont une structure
encyclopédique, grâce aux plus anciens textes en roumain datant du XVIème
siècle, mais aussi à des textes encore plus anciens, écrits dans les langues de
chancellerie et de culte qui ont orné les témoignages du passé dans l’espace
roumain: le slavon en tout premier lieu, ensuite le latin, le turc osmanli, le
roumain. »
Celui ou celle qui lance une recherche sait parfaitement que
le point de départ est le regard posé sur le passé, afin d’apprendre les
contributions de gens d’autrefois. C’est ainsi que, affirme Ioan-Aurel Pop,
lire les textes antérieurs est une condition obligatoire pour une recherche de
qualité : « Les collections spéciales du patrimoine de notre bibliothèque
lui assure une place de choix parmi les institutions similaires qui détiennent
de tels témoignages en Roumanie. Ainsi, la collection de manuscrits est-elle la
plus riche du pays, tandis que les collections des Cabinets des estampes, des
monnaies, de musique, des cartes, sont de véritables références en la matière.
Il est impossible de réaliser un ouvrage d’histoire des sciences, des
disciplines proprement-dites, ou d’histoire de la culture sans faire appel à
cet établissement extraordinaire. La bibliothèque est une institution vivante,
qui organise des conférences, notamment ces dernières années. »
Un premier volume a donc commencé à
raconter l’histoire de la Bibliothèque de l’Académie roumaine. C’est un effort
de longue haleine, que les gens de culture viennent à peine de lancer. (Trad.
Ileana Ţăroi)