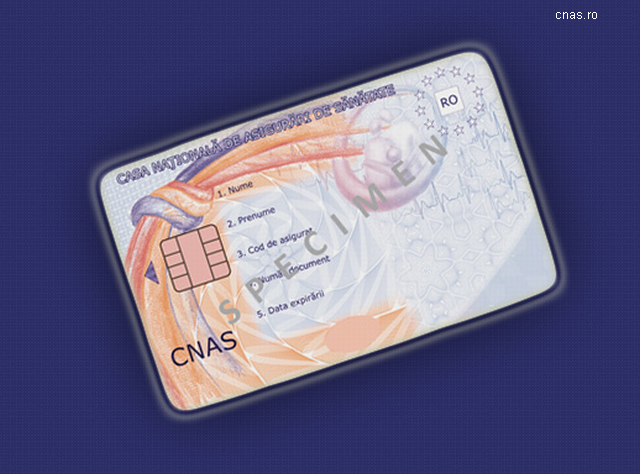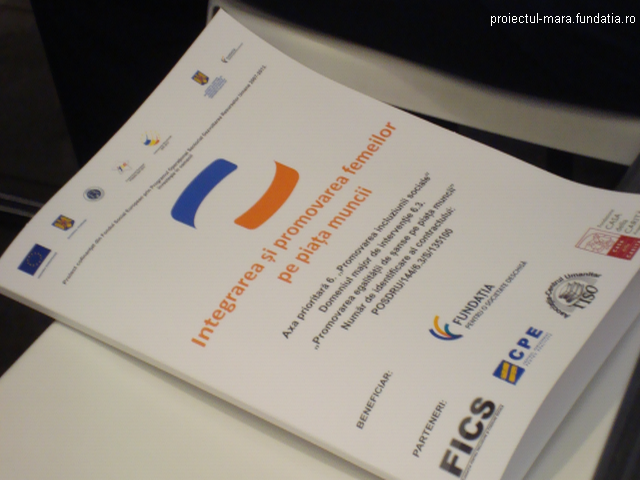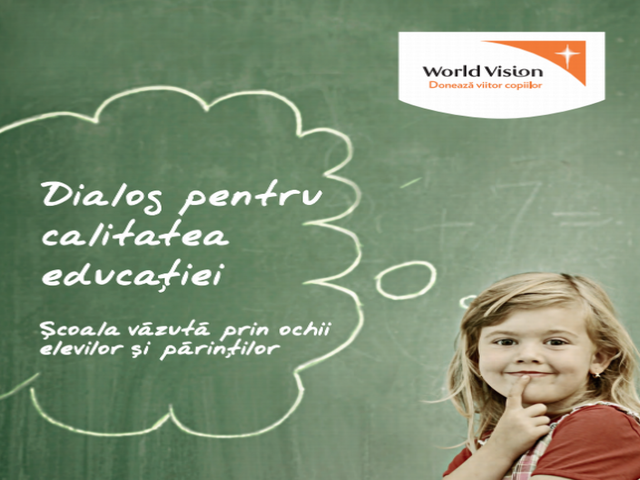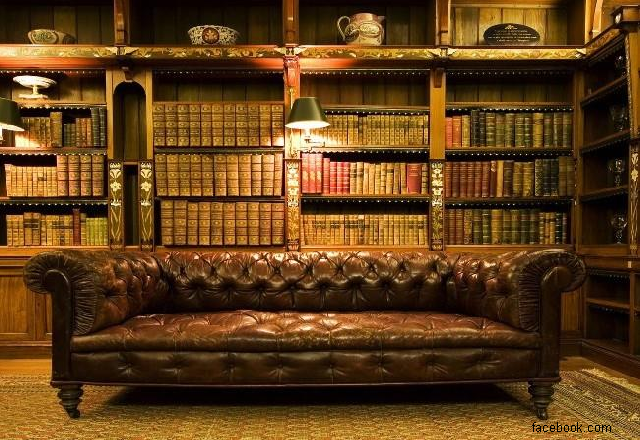En Roumanie, les soins de santé fonctionnent généralement en régime public. Bien que de nombreux cabinets médicaux, cliniques et même hôpitaux privés aient été ouverts ces dernières années, ils sont financés, eux aussi, pour la plupart, par le système d’assurance maladie public. Cela revient à dire que les employeurs et les salariés y versent un certain quota de leurs revenus; les fonds ainsi collectés sont gérés par la Caisse nationale d’assurance maladie.
Ce quota — qui est de 5,2% pour l’employeur et de 5,5% pour le salarié — assure le paiement intégral d’un paquet de services médicaux de base et des urgences. Les Roumains peuvent se procurer parallèlement d’autres services médicaux, en choisissant de cotiser à un système privé d’assurance maladie, sans qu’ils puissent pour autant renoncer au public. Combien de Roumains souscrivent à une assurance privée ? Une étude GFK Roumanie montre que 93% des Roumains ont souscrit uniquement à l’assurance maladie publique.
Ana Maria Drăgănică, gérant de compte de la compagnie, explique: « La grande majorité de la population bénéficient d’une assurance maladie dans le système public de santé. 2% seulement des personnes interrogées déclarent être abonnées à une clinique privée. Dans ce cas, soit elles paient intégralement l’abonnement, soit l’employeur y contribue. Et ce sont toujours 2% des Roumains à avoir souscrit à une assurance de santé privée. Donc, 4% seulement de la population ont recours au système médical privé. »
Nous avons demandé à une assurée du système public pourquoi elle ne souscrivait qu’à une telle assurance maladie: «Parce que c’est obligatoire. Si j’avais pu, j’aurais choisi le système privé, mais il aurait fallu que ce l’un ou l’autre, pas les deux, comme à présent : à part la cotisation au système public, on doit payer la cotisation au système privé. Moi, j’aurais choisi le système privé car l’accès aux services médicaux est plus facile. On peut appeler, fixer un rendez-vous pour une consultation. A part ça, je trouve que dans le système privé les cabinets médicaux sont plus modernes, dotés de nouvelles technologies, ce qui n’est pas le cas dans le système public. »
Les analystes du système de santé de Roumanie expliquent, eux, dans d’autres termes la réticence des patients à souscrire à une assurance maladie privée, qu’ils lient plutôt à des facteurs économiques et à une certaine vision du rôle de l’Etat. Nous passons le micro au médecin Gabriel Diaconu : « Le système de santé de Roumanie détient une sorte de monopole, le marché des assurances maladie étant dominé par l’Etat par le biais des lois. Théoriquement, rien n’entrave le marché des assurances privées, pourtant, la présence des assureurs privés est plutôt réduite, car limitée par l’offre de l’Etat ; celui-ci estime — au niveau du discours public — que la santé est une question qui lui incombe et qu’elle ne doit pas être une source de profit. Autrement dit, l’Etat social investit et redistribue une richesse qu’il accumule par les contributions de la population. »
Une chose est sûre : la plupart des Roumains ne veulent pas ou ne peuvent pas payer deux assurances médicales — l’une publique, l’autre privée. S’y ajoute leur perception des différences de coûts entre les deux systèmes. Lorsqu’on lui a demandé si une assurance privée lui coûterait davantage qu’une assurance publique, sans avoir fait des calculs, notre interlocutrice de tout à l’heure pense que : « Le système privé semble plus cher que le public. »
Pour ce qui est des coûts, les choses se compliquent, en raison des paiements informels — l’argent ou les cadeaux que le patient offre au personnel de la santé pour s’assurer de la qualité des soins. Ce à quoi s’ajoute la mentalité du patient roumain. Gabriel Diaconu : « Consulter un médecin est une question de nécessité et non pas une question de santé. Nécessité veut dire des douleurs insupportables que l’on n’arrive pas à atténuer par le traitement recommandé par des amis ou des pharmaciens. Il s’agit là d’une éducation précaire des gens, qui ne prévoient jamais un budget pour leur santé et qui ne pensent jamais à leur santé de manière proactive. Pourtant, si l’on additionnait les paiements informels offerts au chirurgien pour une intervention en cas d’appendicite, par exemple, et tous les autres coûts liés au fait de s’être absenté du travail, la somme obtenue dépasserait celle que l’on aurait payée à un assureur privé. Un autre facteur s’y ajoute : la proximité. Dans les régions, les gens disposaient d’un réseau de proximité qui incluait le médecin traitant, celui de l’hôpital départemental qu’ils connaissaient. Mais la réalité a changé ces derniers temps aussi à cause de la migration des médecins.”
L’étude de l’agence GFK ne prend pas en compte un autre aspect. Beaucoup de Roumains ont recours aux cabinets médicaux privés où ils paient les consultations directement à la caisse et non pas par le biais d’une assurance ou d’un abonnement. Gabriel Diaconu: « Les personnes qui se rendent à une clinique privée le font comme s’il s’agissait d’un hypermarché de services médicaux. Ils viennent demander des analyses de laboratoires sans demander l’avis d’un médecin. Or, dans le système public, la procédure dit que le médecin traitant envoie le patient consulter un spécialiste. »
Parmi les personnes interrogées dans le cadre de l’étude mentionnée, on peut déceler une autre catégorie. Ana-Maria Drăgănică, gérant de compte de la compagnie, nous en parle : « Plus de 15% des personnes interrogées âgées de 18 à 34 ans ne bénéficient d’aucun type d’assurance maladie. Leur situation est extrêmement délicate et constitue un signal d’alarme pour les deux systèmes d’assurance — public et privé. »
Ces personnes font-elles partie de ceux qui vont payer directement la facture aux caisses des cabinets médicaux privés ? Le médecin Gabriel Diaconu n’est pas sûr : « Je ne le pense pas, car ces zones à déficit d’assurances publiques sont très pauvres, ont un taux de chômage élevé et un taux de mortalité prématuré élevé. Pour ces gens-là, ni le système des assurances publiques, ni celui des assurances privées n’ont trouvé une solution. »
Prévue à plusieurs reprises et de différentes façons, en fonction de la vision sociale des gouvernements au pouvoir à Bucarest ces dernières années, la réforme de l’assurance maladie attend encore sa forme définitive.