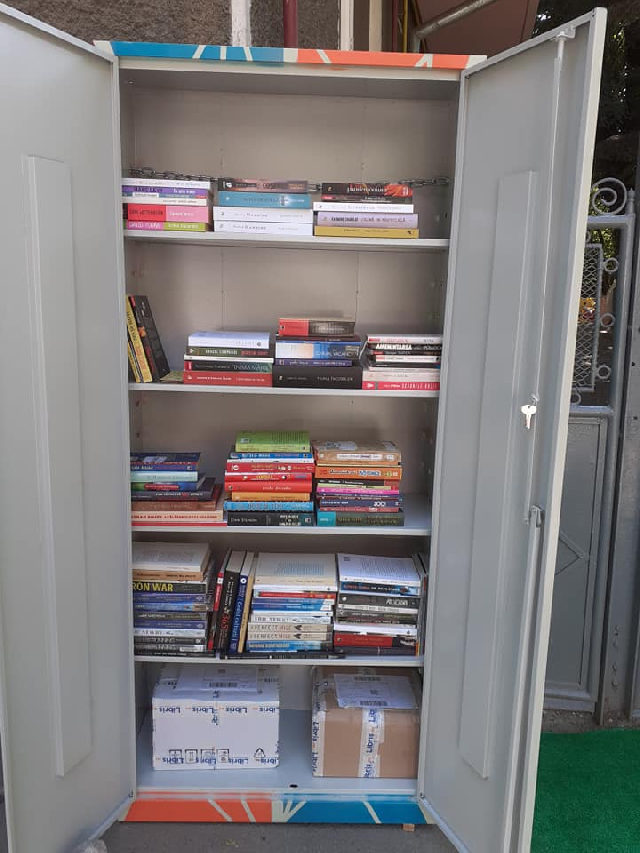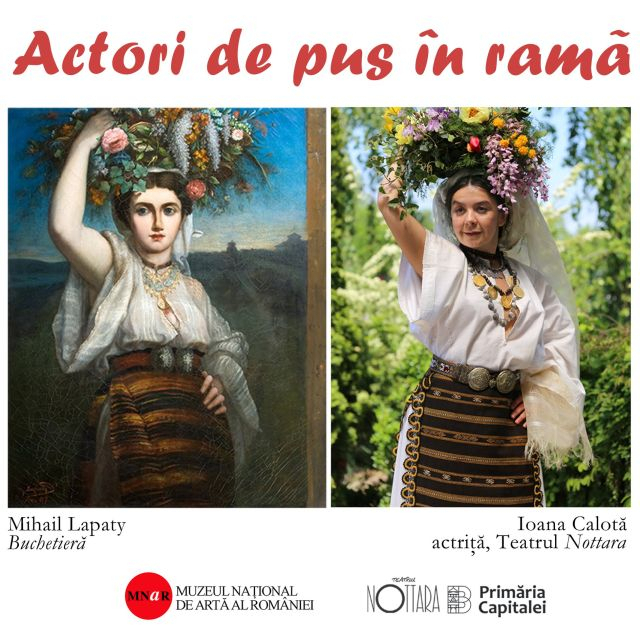Eh bien, la réponse est « oui », contrairement au mythe selon lequel les philosophes sont des personnes qui n’ont pas vraiment de rapport réel avec le monde concret. C’est ce qu’affirme, arguments à l’appui, Laurentiu Staicu, professeur à la Faculté de philosophie de l’Université de Bucarest, dans son récent volume « Socrate en jeans ou la philosophie pour les adolescents », publié chez la maison d’édition Trei. Pourquoi a-t-il choisi de s’adresser à cette tranche d’âge ? C’est l’auteur du livre qui nous le dit. Ecoutons Laurentiu Staicu : « L’adolescence est probablement l’âge le plus propice pour une première rencontre avec la philosophie et pour faire de la philosophie. Pourquoi je dis cela ? Parce que l’adolescence est l’âge durant lequel nous sommes suffisamment mûrs pour suivre une idée ou une pensée philosophique. Ce qui plus est, nous sommes encore assez malléables, élastiques et nous pouvons laisser nos lectures philosophiques modeler notre esprit. Une fois adultes, ces choses n’arrivent plus. Cela ne veut pas dire qu’il n’est pas bien de lire de la philosophie après l’adolescence, mais à l’âge adulte nous ne sommes plus aussi disposés à changer la manière de regarder le monde. Par ailleurs, il est vraiment étrange de voir que l’on écrit peu d’œuvres philosophiques pour les adolescents. On écrit beaucoup d’ouvrages introductifs à la philosophie pour les adultes et les enfants, mais moins pour les adolescents. C’est pourquoi j’ai pensé combler cet espace vide et j’ai écrit une introduction à la philosophie dédiée notamment aux jeunes. »
Et vu que le dialogue était le moyen d’investigation philosophique préféré par Socrate, les chapitres du livre sont en fait des dialogues entre deux lycéens avec le grand-père philosophe de l’un des deux au sujet de concepts fondamentaux tels la liberté, la justice, l’amour et la vérité. Laurențiu Staicu : « Le dialogue est une forme de communication beaucoup plus amicale, beaucoup plus ouverte. Je ne pourrais jamais imaginer – et là je m’exprime en tant que professeur expérimenté à la Faculté de philosophie – un adolescent lisant avec passion un ouvrage philosophique dans lequel l’auteur fait un véritable monologue sur un certain thème. Cette forme de communication est moins accessible. C’est pourquoi j’ai opté pour le dialogue, parce qu’il rend possible une implication personnelle, il nous permet de participer au débat. En plus, le dialogue permet à l’auteur de présenter plusieurs points de vue, même s’il s’agit d’une tâche plus difficile à réaliser. Il faut présenter plusieurs points de vue sur le même sujet, ce qui est évidemment plus compliqué. »
En Roumanie, la philosophie est enseignée uniquement aux élèves en terminale, soit à des jeunes de 17 – 18 ans. Cela est carrément insuffisant, affirment certains experts éducationnels. La philosophie devrait-elle être enseignée à commencer par les premières années de lycée ou bien même à partir du collège ? Ecoutons l’opinion de Laurentiu Staicu : « Oui, à condition de savoir comment s’y prendre. Comme nous l’avons déjà affirmé, l’adolescence est l’âge le plus approprié pour une rencontre sérieuse avec la philosophie. Cela ne veut pas dire que cette rencontre ne peut pas avoir lieu plus tôt, mais l’enfant n’est pas suffisamment mûr, il n’est pas prêt à suivre l’idée philosophique jusqu’au bout. La pensée philosophique est très abstraite et elle doit être simplifiée pour être comprise par des enfants plus jeunes. Il faut beaucoup schématiser, mais cela ne veut pas dire que c’est irréalisable. Il est d’ailleurs très utile de nous rendre compte de cela. Il faut seulement avoir la volonté de le faire et dépasser ce préjugé selon lequel la philosophie est uniquement réservée aux personnes qui veulent vivre la tête dans les nuages et ne disposent pas de capacités utiles dans la vie. Et cela est complètement faux. » Et c’est justement ce que le livre « Socrate en jeans ou la philosophie pour les adolescents » souhaite démontrer.