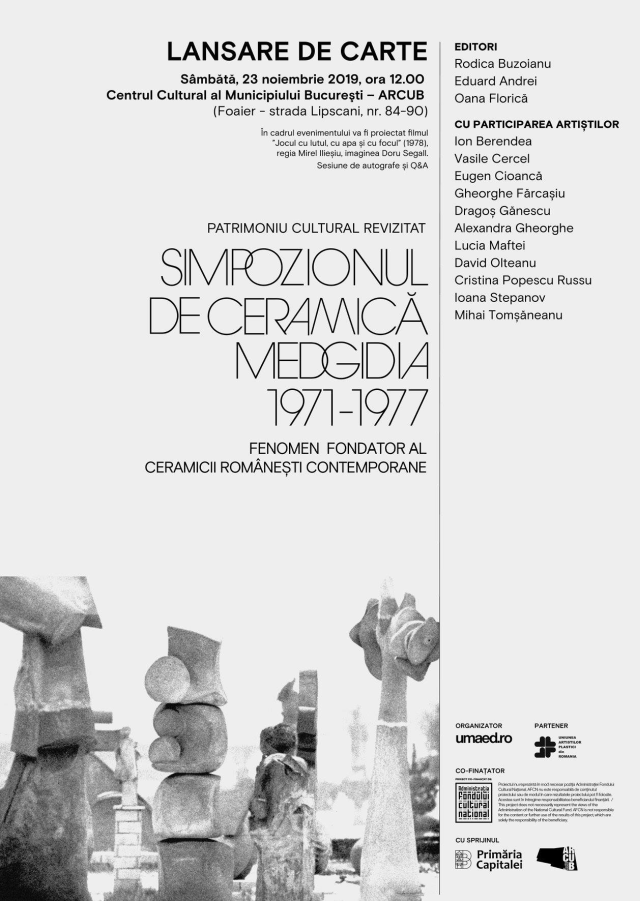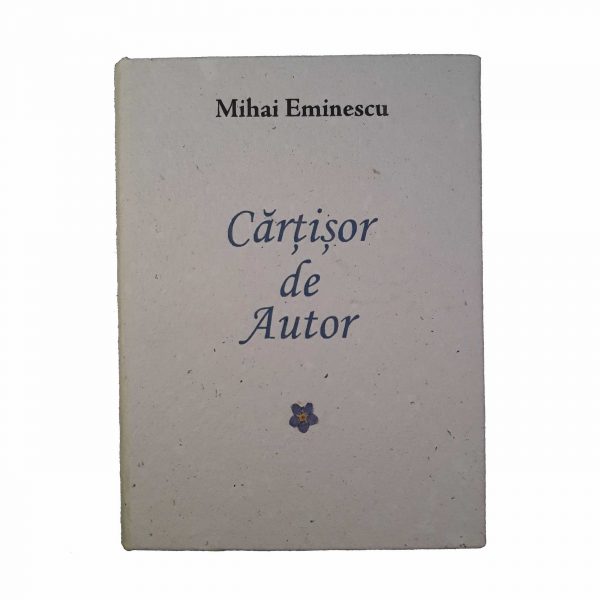Connue depuis l’Antiquité pour ses eaux aux
propriétés thérapeutiques, la petite ville d’Herculane-les-Bains a peu à peu acquis
un statut de station balnéaire de luxe. C’est au cours du 19-e siècle que la
ville atteint l’apogée de sa gloire. Aujourd’hui, pas moins de 74 objectifs,
sites archéologiques, statues, monuments et ensembles architecturaux, se
trouvent que la Liste des monuments historiques de Roumanie. A la fin du 19-e
et au début du 20-e, c’est ce patrimoine qui faisait de Herculane-les-Bains une
des destinations les plus prisées du continent européen. Qui plus est, la ville
est au cœur d’un parc naturel très pittoresque de l’ouest de la Roumanie,
Domogled-Valea Cernei. Eaux thermales, sorties en nature et beautés
architecturales, le tableau semble parfait. Hélas, depuis des années le centre
historique de la ville est en proie à une dégradation accélérée à cause,
surtout, de problèmes juridiques engendrés par une privatisation douteuse.
Ce qui se passe actuellement avec les bâtiments
historiques d’Herculane-les-Bains est « une tragédie nationale »,
d’après l’architecte Oana Chirilă, membre de l’association Herculane Project.
En 2017, elle a initié, avec un groupe d’étudiants en architecture enthousiastes,
ce projet de revitalisation de la zone historique d’Herculane. Pour commencer,
ils ont choisi un monument majeur de la ville : les Thermes de Neptune, vieux
centre de traitement et de relaxation. Oana Chirilă : « Herculane
Project est ce que nous appelons une plateforme de réactivation. Réactiver ou
redonner vie au centre historique d’Herculane-les-Bains. Nous avons deux
directions d’action principales. Tout d’abord, réactiver les Thermes de
Neptune, c’est notre premier projet, qui occupe la plupart de notre temps.
Ensuite, réactiver culturellement et socialement le centre historique par
différents projets. Nous ne souhaitons pas uniquement redonner vie à un
monument, mais aussi changer l’offre culturelle actuelle. Nous ne pouvons pas
nous contenter de restaurer les bâtiments, de leur offrir des fonctions qui
généreraient du développement économique ou social. Nous visons aussi à changer
les mentalités, à éduquer, à réintroduire ces lieux historiques dans la
communauté. Et je ne pense pas seulement à la communauté locale, mais aussi aux
gens de passage. Comme c’est une station balnéaire, environ 100.000 personnes
viennent à Herculane chaque année. Les ressources existent, il faut juste les relier
entre elles. C’est ça la réactivation, pour résumer. »
Pour le moment, il n’est pas possible de
réellement restaurer les bâtiments historiques de la ville, alors les bénévoles
travaillent seulement à consolider les Thermes de Neptunes. Oana Chirilă : « Pour
ce qui est des Thermes, justement parce qu’il existe un blocage juridique et
plusieurs saisies sur le terrain affèrent, nous avons pu seulement faire
quelques interventions d’urgence. Malheureusement, le bâtiment, y compris au
niveau de sa structure, a été endommagé avec le temps. Alors nous avons fait des
travaux, temporaires et réversibles, afin de conserver et de maintenir
l’immeuble en l’état, en attendant la restauration. Pour le moment, nous
voulons finaliser cette intervention. Nous en sommes à la moitié et avons dû
nous arrêter, faute d’argent. Nous avons tout fait avec l’aide de la société
civile. Nous avons collecté quelque 60.000 euros de dons et sponsoring, que
nous avons ensuite utilisés pour ce bâtiment. »
Herculane Project a besoin de 100.000 euros, en
tout, pour finaliser les travaux aux Thermes de Neptune. Oana Chirilă : «
Nous préparons une campagne pour cet été. Nous visons plus large et voulons
réactiver d’autres monuments aussi. On aura cette collecte de fonds et nous
continuerons à soutenir l’administration locale pour ce qui est de la future
fonction de l’immeuble. Une partie de nos sponsors sont intéressés de
s’impliquer aussi dans la restauration, quand le moment viendra. Voilà pour
notre activité du moment. Mais le plus urgent reste de finaliser
l’intervention, car il y a des endroits que nous n’avons pas encore consolidés,
comme le toit, par exemple. »
Un autre objectif majeur de l’association
Herculane Project est de faire inscrire l’ensemble architectural d’Herculane-les-Bains
au patrimoine mondial de l’UNESCO. Le processus est en cours, l’association a
démarré les discussions avec les autorités roumaines et avec le comité UNESCO.
(Trad. Elena Diaconu)