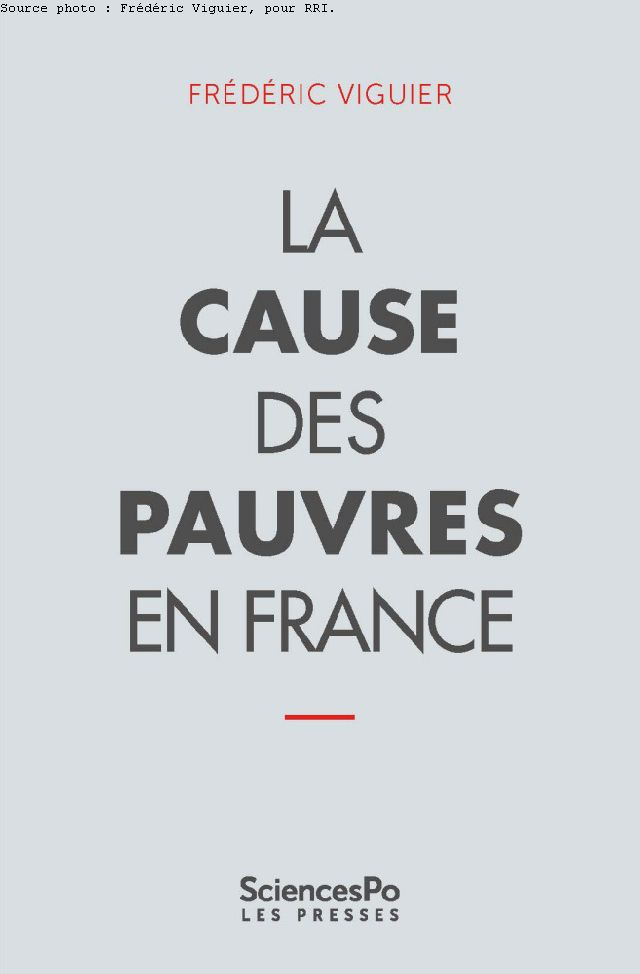Le comté d’Alba attire ses visiteurs notamment dans la ville d’Alba Iulia, qui possède une multitude de monuments historiques importants et très bien conservés, vestiges d’un passé millénaire. Depuis la zone urbaine, nous nous dirigeons vers les Monts Apuseni. C’est là que vous pouvez pratiquer l’escalade, l’alpinisme, vous pouvez visiter des grottes inédites et pas dernièrement – découvrir le village traditionnel roumain. Violeta Nica, porte-parole au Conseil départemental d’Alba, souligne qu’il s’agit là d’un des comtés les plus beaux de Roumanie : « Avec un potentiel touristique à part, le département d’Alba est remarquable non seulement par ses paysages d’une beauté unique, mais aussi par son histoire, sa culture et ses traditions. Par conséquent, sachez que dans ce comté on peut pratiquer différents types de tourisme, tel le tourisme culturel et historique, le tourisme écologique, religieux et évidemment, le tourisme en montagne. Pour ce qui est du tourisme culturel et historique, il faut commencer par la ville d’Alba Iulia. La cité Alba Carolina, la fortification de type Vauban la plus représentative de Roumanie et une des plus importantes d’Europe, est la principale attraction de la ville et du département. Annuellement, des dizaines de milliers de touristes visitent la cité, et ils sont nombreux en toute saison. La relève de la garde, le tour des fortifications, les groupes statuaires, l’obélisque de Horea, Closca et Crisan ne sont que quelques-uns des points forts de la citadelle, auxquels s’ajoutent les festivals romains et les spectacles en plein air. Le principal objectif est la Cathédrale du Couronnement, aux côtés de laquelle se trouve la Cathédrale catholique Saint Michel. Et c’est également à l’intérieur de la citadelle que les touristes peuvent visiter le Musée national de l’Union et la Salle de l’Union récemment remise à neuf, un bâtiment d’une grande importance historique pour les Roumains, ainsi que le Museikon, l’unique musée de l’icône de Roumanie ou bien la bibliothèque Batthyaneum. »
Les principales attractions à visiter dans le département d’Alba se trouvent un peu partout, explique Violeta Nica : « Dans le même registre, nous arrivons à Blaj, où toute visite devrait commencer par la Plaine de la liberté, un endroit à part pour tous les Roumains, pour se poursuivre par le Palais de l’Archevêché, bâti au 13e siècle, le Palais de la culture et par le Jardin botanique, ouvert en 1881, qui est d’ailleurs le plus vieux du monde. Il est aménagé auprès d’une école secondaire. La ville d’Aiud est également un important centre culturel. Le comté d’Alba concentre un grand nombre de monuments historiques d’une importante valeur au niveau national, leur liste publiée en 2015 compte 686 objectifs. Mentionnons deux de ces sites : la cité dacique de Capâlna, des monts Orastiei, et le site rural de Câlnic, qui fait partie de ces localités saxonnes dotées d’églises fortifiées. Les deux sont en fait des monuments historiques figurant sur la liste du Patrimoine mondial de l’UNESCO. Des démarches sont entreprises pour ajouter à cette liste les sites de Rimetea et de Rosia Montana. Nous rencontrons en milieu rural un patrimoine riche par l’originalité de l’architecture, dans des communes telles Arieșeni, Gîrda, Vidra, Avram Iancu, Albac, Mogoș, Ponor, Râmeț, très connues de ce point de vue. »
Par ailleurs, le cadre naturel du département d’Alba se fait remarquer surtout par l’harmonie, explique Violeta Nica, porte-parole du Conseil départemental : « Les paysages naturels pittoresques constituent une offre riche et variée, avec des grottes, des rochers, des cascades, des gorges, des massifs tels : Râpa Roșie, les gorges de Râmeț et celles d’Aiud, Detunatele. Le glacier de Scarisoara est une réserve naturelle d’importance européenne. Mentionnons aussi les ressources balnéaires d’Ocna Mures, localité que le Conseil départemental se propose de transformer en station de luxe. Également à voir – le train de type decauville de la Vallée de l’Aries ou bien les terrains de golf de Pianu, les plus étendus de toute la Roumanie. Plus de 25 % du territoire du département d’Alba est classé aire naturelle. C’est sur ces bases que le tourisme vert s’est développé. »
Un des projets remarquables du Conseil départemental, c’est la réhabilitation d’une route départementale qui traverse plusieurs communautés isolées des Monts Apuseni, pour dévoiler des paysages tout à fait spectaculaires. Violeta Nica : « Il s’agit de ce que l’on appelle « la transalpine des monts Apuseni » d’après le nom de la route Transalpina qui traverse le massif de Fagaras. Cette route part d’Aiud et arrive à Bucium en passant par des crêtes de plus de mille mètres d’altitude. Elle suit l’itinéraire de la route médiévale du Pays des Moti et joue plusieurs rôles. Elle relie des communautés traditionnelles authentiques, c’est une route de la culture, qui passe par des lieux qui évoquent l’enfance de l’écrivain roumain Ion Agârbiceanu. Elle est également un chemin historique, qui refait en quelque sorte l’ancienne route romaine de l’or, mais c’est aussi et surtout une voie de la confession, qui monte depuis les cimes du massif de Trascau aux portes du monastère de Râmeț. Le tableau peut être complété par le tourisme œnologique et gastronomique, puisqu’il s’agit bien de « la Contrée du vin ».
Enfin, dans le département d’Alba, les vacanciers peuvent également pratiquer le tourisme religieux et actif. Les passionnés des sports d’hiver y trouveront un endroit parfaitement adapté à des vacances actives. Violeta Nica, porte-parole du Conseil départemental d’Alba, précise : « Il existe une liste impressionnante d’églises et de monastères du département d’Alba figurant au circuit touristique. Commençons par la Cathédrale du Couronnement et la Cathédrale catholique Saint Michel d’Alba Iulia. Nous continuons par le Palais de l’Archevêché de Blaj et les monastères de Râmeț et Ponor, sans pour autant oublier les églises en bois du département, qui constituent un véritable trésor. Par ailleurs, les montagnes donnent un véritable spectacle. Les passionnés des sports d’hiver disposent du domaine skiable de Sureanu et de la station de montagne d’Arieseni. Le projet de développement le plus récent concernant les Monts Apuseni fait l’objet d’un accord d’association entre le Conseil départemental d’Alba et celui de Bihor qui attendent également la participation du Conseil départemental de Cluj et qui vise entre autres le développement et la promotion touristique de la région de montagne située entre ces départements. »
Le nombre des structures d’hébergement vient de tripler ces 10 dernières années, pour arriver à une capacité totale de 6 000 places. Dans l’offre d’hébergement touristique, les gîtes ruraux de petites dimensions situés dans la région des Monts Apuseni dominent. Voilà donc autant de bonnes raisons de visiter la ville d’Alba Iulia et le département d’Alba. A bientôt !