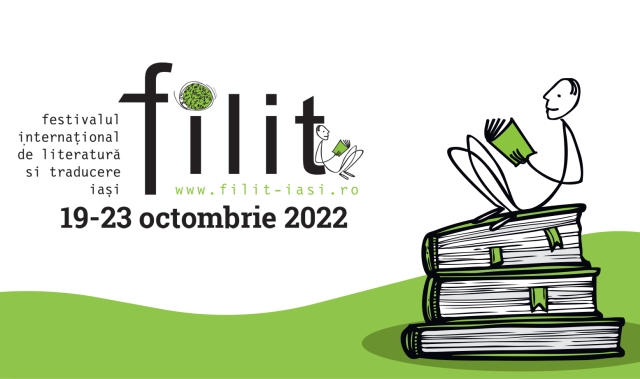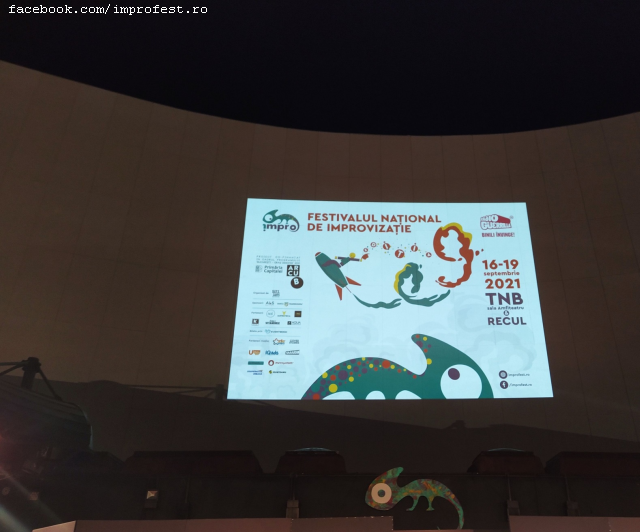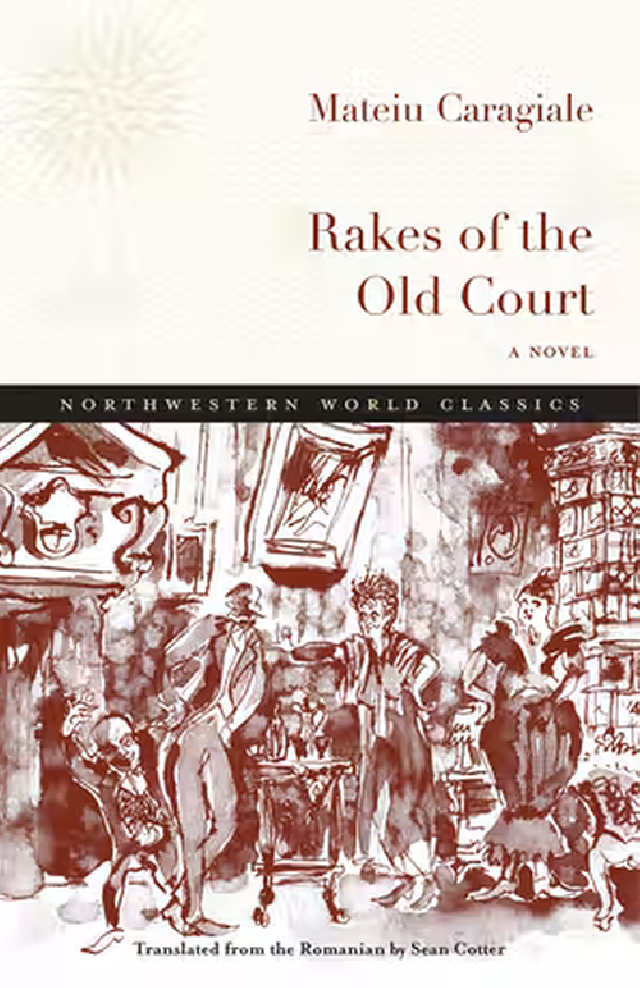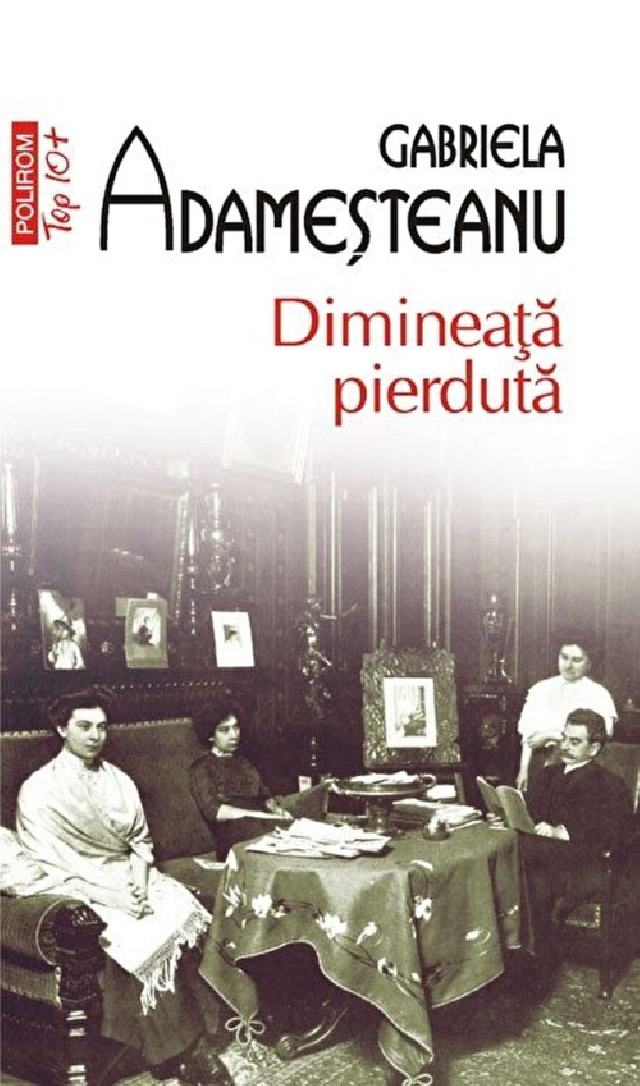ARCUB (le Centre
culturel de la ville de Bucarest) et l’Union des Artistes Plasticiens de Roumanie ont récemment
présenté une nouvelle édition du projet « Arte în București/Des arts à
Bucarest ». Expositions, ateliers, conférences et classes de maître, consacrés
tous aux arts décoratifs, ont été réunis sous le titre générique « Deco
ReMake ». Structuré autour de plusieurs expositions centrales, ouvertes
dans différentes salles de la ville, ce projet – « Deco ReMake »- se
veut un panorama des arts décoratifs du point de vue des concepts
d’organisation et des pratiques artistiques contemporaines. L’idée à la base
était d’éduquer et de familiariser le grand public avec des techniques et des
processus utilisés dans la réalisation des objets d’art décoratifs. Dorina
Horătău, coordinatrice générale du projet a détaillé la mise en page de
celui-ci:
« Pour cette neuvième édition de « Arte
în București », dédiée aux arts décoratifs, nous avons cherché des titre
et celui de « Deco ReMake » a été le meilleur, puisque, pour moi, « re-make »
signifie une mise à jour des ces arts. Comment? Eh bien, les arts majeurs ont
beaucoup emprunté aux techniques de base des artistes décorateurs et les mettent
ensemble avec les principes de l’art contemporain et surtout avec un concept. De très nombreux
artistes, actifs dans le décoratif, trouvent difficilement le courage de
franchir la barrière d’un message ancré dans l’actualité. Aux éditions
précédentes, les arts décoratifs étaient intégrés aux majeurs, donc ils avaient
moins de force. Dans un projet, on construit, on obtient des résultats et un
impact sur les autres. Outre les expos, nous avons souhaité réaliser des
rencontres des artistes décorateurs avec le public, pour présenter le processus
de création de ces objets et la technologie utilisée. Nous utilisons des
formules bien définies et il est important de montrer la manière dont ces
formules et recettes de matériaux sont mises ensemble, tout comme la façon de
l’artiste d’exprimer son message à travers l’objet créé. Ce que l’on cherche le
plus souvent c’est de se connecter aux concepts et de dialoguer avec le public.
Cette année, j’ai travaillé merveilleusement bien avec la commissaire générale
Ana Negoiță, avec Georgiana Cozma et Marian Gheorghe. C’est le meilleur moment
d’échanger avec les jeunes. »
La
commissaire générale Ana Negoiță a expliqué les concepts et les critères
artistiques sur lesquels repose le projet « Deco ReMake »:
« Ce projet contient deux trucs bizarres,
qu’il faut prendre tels quels. Je m’explique : c’est un projet qui ne
s’assoit pas sur un concept organisateur, autour duquel s’assemblent les
créations exposées, comme c’est souvent le cas puisque c’est la pratique
générale. Il découle d’un projet de la filiale d’Art décoratif – c’est-à-dire
textile, verre, métal et céramique – et tente de rassembler ces gens à travers
un certain discours. Et c’est là qu’apparaît le rôle de l’équipe de
commissaires, que nous avons tous assumé. C’est un travail interdisciplinaire,
où moi, j’apporte une perspective théorique, alors que mes collègues proposent
une perspective pratique. Il a donc fallu rassembler les objets dans une
démarche dépourvue de critères de sélection, et ce n’est pas simple de mettre
en place une exposition en l’absence de tels critères et obtenir un discours
unitaire. Alors, notre fil rouge a été l’espace utilisé, afin de donner une
nuance contemporaine aux arts décoratifs, puisque nous bataillons encore en ce
sens. Ces arts ont un caractère statique, donc il faut les orienter vers des
installations et des structures interdisciplinaires, où il n’y ait plus que du
textile ou du métal. Les techniques mixtes expriment un regard particulier posé
sur l’objet du point de vue de l’installation ou même d’une structure
performative, telle la vidéo. Ceci est très important et ce n’est pas facile de
faire passer ce type de discours dans les rangs des séniors.
Enfin, le
président de l’Union des artistes plasticiens de Roumanie, Petru Lucaci, s’est
exprimé sur le projet « Deco ReMake »:
« C’est un projet que nous avons lancé il
y a un certain temps déjà et dont les éditions précédentes se sont déroulées
dans des contextes et des lieux divers. Nous essayons d’élargir la gamme de nos
intérêts dans le plus grand nombre de domaines, car l’Union des artistes
plasticiens, qui rassemble plus de 6.000 membres, a une dizaine de parcours de
carrière différents, des départements qui essaient de mettre en avant leurs
propres image et activité. Cette fois-ci, nous avons voulu mettre en lumière
les arts décoratifs, non seulement parce qu’ils sont devenus une zone d’art
majeur. C’est quelque chose de novateur, qui vient compléter le paysage de
l’art contemporain avec des éléments significatifs. À présent, la section
d’arts décoratifs se montre impeccable. C’est un espace d’expo muséal, large,
qui permet de mettre en valeur chaque ouvrage et de créer une relation
expressive et intéressante entre les objets exposés. L’UAP a un énorme
potentiel, un très grand nombre de membres est plus difficile de les rassembler
et de créer des événements qui parlent à tous. C’est un type de comportement.
Ces dernières années, nous avons voulu insister sur ce type de discours visuel,
qui permet d’articuler un espace d’exposition d’un niveau élevé, qui soit
vraiment quelque chose d’intéressant sur la scène de l’art contemporain de
Roumanie. »
(Trad. Ileana Ţăroi)